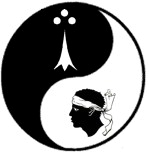Nous avons en France — et donc aussi en Corse, pour le moment — une chance formidable. Nous avons un Président de la République champion dans l’art de la manipulation, et sommes donc aux premières loges pour alimenter ce Petit dictionnaire… Aujourd’hui, j’ai choisi le mot Provocation. Et, puisque nous avons des exemples très récents sous la main, à la suite de la visite d’Emmanuel Macron en Corse le 4 avril, j’ai choisi de traiter ce mot d’une façon différente des autres articles de ce dictionnaire. Plutôt que de la théorie, je vous propose des travaux très pratiques, appliqués à notre situation en Corse. Je fais une totale confiance à nos lecteurs pour décaler ces exemples et appliquer le schéma à leurs propres contextes. Dernière précision avant d’entrer dans le vif du sujet : loin de moi l’idée de donner des leçons à qui que ce soit. Déjouer une provocation est ce qu’il y a de plus difficile en matière de maîtrise des situations conflictuelles. Je forme depuis des années des chefs d’entreprises à cette thématique, et je n’ai trouvé encore aucune recette miracle. Mais donner des options, des cartes différentes ne peut qu’être une ouverture bénéfique. C’est ce que j’essaie de faire dans les lignes qui suivent.
Nous avons en France — et donc aussi en Corse, pour le moment — une chance formidable. Nous avons un Président de la République champion dans l’art de la manipulation, et sommes donc aux premières loges pour alimenter ce Petit dictionnaire… Aujourd’hui, j’ai choisi le mot Provocation. Et, puisque nous avons des exemples très récents sous la main, à la suite de la visite d’Emmanuel Macron en Corse le 4 avril, j’ai choisi de traiter ce mot d’une façon différente des autres articles de ce dictionnaire. Plutôt que de la théorie, je vous propose des travaux très pratiques, appliqués à notre situation en Corse. Je fais une totale confiance à nos lecteurs pour décaler ces exemples et appliquer le schéma à leurs propres contextes. Dernière précision avant d’entrer dans le vif du sujet : loin de moi l’idée de donner des leçons à qui que ce soit. Déjouer une provocation est ce qu’il y a de plus difficile en matière de maîtrise des situations conflictuelles. Je forme depuis des années des chefs d’entreprises à cette thématique, et je n’ai trouvé encore aucune recette miracle. Mais donner des options, des cartes différentes ne peut qu’être une ouverture bénéfique. C’est ce que j’essaie de faire dans les lignes qui suivent.
Un terme injustement banalisé
Provoquer une réaction est l’essence même de la communication, quelle qu’elle soit. Sauf à être pathologiquement isolé, on cherche toujours, lorsque l’on échange avec quelqu’un, à obtenir un retour, positif ou négatif, simple accusé de réception ou enrichissement de l’échange, sourire, geste, parole… Rien n’est pire que de parler à quelqu’un qui ne réagit pas : parler à un mur, comme le veut l’expression.
Mais la provocation, quand on utilise le mot sans complément — provocation seul et non provocation à —, ne consiste pas à chercher n’importe quelle réaction. La provocation, selon Wikipédia, désigne l’action de pousser un individu à commettre un acte qui paraisse ou non involontaire et qui défavorise le provoqué. Le Larousse va même plus loin, en précisant : Action de provoquer quelqu’un, de le pousser à commettre une action blâmable, une infraction […] Acte par lequel on cherche à provoquer une réaction violente ; Incitation à commettre un crime ou un délit par dons, promesses, menaces, abus d’autorité, ordre, ce qui est assimilé à un acte de complicité.
On le voit, la provocation a clairement sa place dans notre Petit dictionnaire des manipulations. Elle y a même une place de choix, car c’est une des façons les plus redoutables de manipuler. Autant on peut, avec un peu de vigilance, mettre à jour les manipulations dont nous nous sommes fait écho dans nos précédents articles, autant une provocation bien conduite se voit souvent trop tard pour agir : c’est la réaction à la provocation qui la démontrera, et le piège se sera lors refermé.  A l’instar du zugswang 1 au jeu d’échec, le provoqué est obligé de réagir et n’a que de mauvaises réactions possibles…
A l’instar du zugswang 1 au jeu d’échec, le provoqué est obligé de réagir et n’a que de mauvaises réactions possibles…
Les provocations d’Emmanuel Macron en Corse
Plutôt que de longs discours théoriques, prenons l’exemple de la dernière visite du

Président de la République en Corse. Il y a, dans son escapade de clôture d’un grand débat qui fut un florilège de manipulations en tous genres, au moins trois provocations.
La première est déjà sa simple présence. Lors de sa visite de février 2018, il avait multiplié les actes tendant à enfermer les représentants légitimes de la Corse dans un rôle de “petits élus locaux” indignes de négociation véritable : discours “provocateur” sur la “non plaidabilité“ de certains crimes face à un des avocats des accusés, fouille au corps des élus avant la rencontre de Bastia, refus de toute présence du drapeau corse, présence de Jean-Pierre Chevènement, l’ennemi acharné des Nationalistes aujourd’hui majoritaires… Mais on pouvait mettre cette attitude sur le compte d’un genre un peu forcé, dans la mesure où sa visite s’inscrivait dans la commémoration de la mort du Préfet Erignac. Et les chantiers en discussion restaient encore ouverts, sur la Constitution comme sur d’autres mesures demandées très majoritairement par les Corses : statut fiscal, enseignement de la langue, par exemple. En 2019, un an de portes fermées s’est écoulé. Aucune des mesures du contrat de mandature de l’actuelle Assemblée de Corse, mesures approuvées par une majorité de 56 % des voix en décembre 2017 — et même parfois plus, puisque certaines d’entre elles sont réclamées par l’Assemblée unanime — n’a trouvé grâce aux yeux du gouvernement français. Et Emmanuel Macron vient en Corse comme dernière étape de son “grand débat”, semblant indiquer que tout ce qui a été débattu jusqu’à présent n’a simplement jamais existé. Mieux, il refuse une invitation à échanger là où ses prédécesseurs se sont toujours rendus, au siège de l’Assemblée de Corse, pour se concentrer sur une discussion avec les seuls maires. Comme si le “grand débat” se devait de mettre de côté tout à la fois le peuple lui-même et ses représentants élus les plus emblématiques.
Deuxième provocation, dans la même veine : à une époque où la simplification administrative est nécessaire, dans un contexte où la majorité des Corses s’est prononcée pour une plus grande autonomie, Emmanuel Macron suggère la mise en place d’une relation directe entre les maires et l’Etat dans une espèce de pseudo-assemblée qui court-circuiterait à la fois l’Assemblée de Corse et sa Chambre des Territoires. Camouflet supplémentaire aux élus légitimes de la CdC ? Volonté de ré-étendre la main tutélaire de l’Etat sur des sujets comme le PADDUC, les PLU, les Espaces Stratégiques Agricoles ?
Troisième provocation enfin, celle qui a depuis “provoqué” les réactions les plus virulentes : la référence renouvelée à la mort du Préfet Erignac, comme une sorte de péché originel que les Corses n’auraient pas encore assez expié pour se voir accorder le droit de discuter de leur avenir avec le représentant de la nation française…
Regardons, point par point, les réponses.

La majorité nationaliste a choisi de ne pas participer au débat de Cuzzà. Y participer aurait en effet signifié avaliser les règles du jeu imposées par Emmanuel Macron au mépris de la démocratie qui s’est exprimée en 2015 et en 2017 en Corse. Mais c’était en même temps d’une part laisser une tribune sans contradicteurs à la minorité qui était présente au débat, d’autre part prêter le flanc à l’accusation de refus de dialogue. En réaffirmant haut et fort leur volonté de discuter des vrais sujets, en invitant le Président à venir débattre à l’Assemblée, la majorité nationaliste a en partie dévié le coup, mais ce n’est qu’un moindre mal. La légitimité du Président de la République à shunter les représentants élus du peuple Corse n’a pas été ébranlée, et d’aucuns — comme le rédacteur en chef de Corse-matin, par exemple — accusent les Nationalistes de s’enfermer dans une posture peu constructive.
Pour ce qui est de la pseudo chambre des territoires version Etat français, il est trop tôt pour savoir ce qu’il adviendra de cette idée, et donc pour parler de réaction. Soulignons simplement que le même type de piège que celui évoqué ci-dessus se présente…
Pour ce qui est enfin de la référence permanente au préfet Erignac, là encore, les réactions sont difficiles. Certains ont rappelé que le peuple Corse avait déjà, dès il y a vingt ans, montré sa réprobation de cet acte, et qu’ils avaient eux-même participé à tous les hommages au Préfet décédé qui se sont déroulés depuis. Ainsi, d’une certaine façon, on avalise l’idée qu’il pourrait y avoir une juste mesure de la contrition, et qu’après tout, Emmanuel Macron pourrait être fondé à penser qu’il faut en faire un peu plus pour se “réhabiliter”. D’autres mettent en parallèle le sempiternel appel à la repentante sur la mort du préfet avec l’absence de repentance française sur d’autres massacres, au premier rang desquels le génocide de 1994 au Rwanda. C’est un parallèle dangereux : d’une part, la France n’a pas participé activement au génocide des Tutsis, d’autre part la démesure même de ce massacre rend dérisoire tout parallèle. Soulignons pourtant la réaction de Jean-Guy Talamoni, qui tranche heureusement tant par sa sobriété que par son équilibre : il a simplement rappelé la tribune qu’il avait signée il y a un peu plus d’un an, De la compassion à la réconciliation, où il appelait à rendre un hommage commun à toutes les victimes du conflit qui a duré quarante ans…
Deux réponses possibles seulement
Sommes-nous donc condamnés à laisser le piège de la provocation se refermer sur nous ? Jean-Guy Talamoni avait déjà début 2018 montré la voie pour déjouer une autre provocation : il avait simplement refusé la fouille au corps que voulait pratiquer le service de sécurité du Président de la République et avait cependant été admis à entrer…
 En fait, il existe deux bonnes réponses à la provocation, et deux seulement. Les deux ont en commun de refuser absolument ce qu’on appelle, en terme de communication, la guerre de tranchées. Le piège en effet se referme complètement si l’on cherche à argumenter. Car le provocateur a alors gagné plus qu’à moitié, en nous obligeant à débattre sur le terrain qu’il a choisi.
En fait, il existe deux bonnes réponses à la provocation, et deux seulement. Les deux ont en commun de refuser absolument ce qu’on appelle, en terme de communication, la guerre de tranchées. Le piège en effet se referme complètement si l’on cherche à argumenter. Car le provocateur a alors gagné plus qu’à moitié, en nous obligeant à débattre sur le terrain qu’il a choisi.
La première bonne réponse est d’ignorer la provocation. La majorité nationaliste l’a fait, en partie, en refusant de participer au débat de Cuzzà. Mais n’aurait-elle pas été encore plus forte en se dispensant de se justifier ? Une simple réponse du genre « Nous attendons les réponses du Président aux débats préalablement engagés avec l’Assemblée de Corse et ne voyons nul intérêt, tant que ces réponses ne sont pas données, à ouvrir de nouveaux terrains de discussion » n’aurait-elle pas suffi ? Et ensuite, on passe à autre chose, on s’occupe de nos propres affaires — Territoire Zéro chômeurs de Longue Durée, agriculture, déchets, cherté de la vie, les sujets ne manquent pas… —, pendant qu’on laisse Emmanuel Macron dérouler son agenda sans s’en soucier davantage. Pourquoi donc laisser la vedette à celui qui méprise et ignore les représentants que le peuple Corse s’est choisi ? Même une “isula morta” est un signe de reconnaissance pour l’initiative de l’Elysée. Le vrai mépris de cette provocation aurait pu consister à faire comme si cette visite n’avait pas lieu. Loin de moi l’idée de donner ici une quelconque leçon. Je sais à quel point une telle attitude est difficile à tenir. Mais cela ne vaudrait-il pas la peine d’y penser, pour… la prochaine fois ?
Une autre possibilité est ce que l’on appelle en négociation le “non puissant”. Là encore, il s’agit de refuser la gué-guerre d’arguments, qui finit toujours par donner le point à celui qui a choisi le terrain, du moins s’il n’est ni suicidaire, ni imbécile. Le “non puissant” n’est pas un “non agressif”. C’est un simple “non” posé là comme un menhir, sans argumentation, mais ferme, inébranlable. La réponse de Jean-Guy Talamoni à la provocation Erignac est de cette veine… Reprise par l’ensemble des nationalises Corses, voire par l’ensemble des acteurs politiques Corses, elle aurait l’immense mérite d’indiquer à Emmanuel Macron qu’il s’enfourne dans une impasse. Portée par le seul Président de l’Assemblée de Corse, elle a déjà le mérite de montrer que celui-ci est insensible à cette tentative de culpabilisation malhonnête, voire indécente. 
Mettre fin à un jeu dangereux
Ce “non puissant“ est bien souvent le seul moyen de mettre fin à l’engrenage de la provocation. Il indique au manipulateur une ligne rouge infranchissable. Sa puissance fait qu’il est aussi très difficile à mettre en place. En l’occurrence, il est pourtant indispensable de trouver les moyens de faire entendre cette puissance.
Car le jeu de la provocation se traduit bien souvent non pas en jeu à somme nulle, mais en jeu à somme négative, en perdant-perdant. Le provocateur n’est pas à l’abri des conséquences de ses provocations. Et si ses provocations déclenchent des violences non maitrisées, qui est le gagnant ? L’histoire abonde en retour de bâtons non anticipés. Nombre de guerres ont débuté par des provocations mal maitrisées, de la Seconde Guerre mondiale 2 à la Guerre du Vietnam 3 . Nombre de révolutions 4 aussi.
La provocation est un jeu dangereux. Regarder en simple spectateur ce jeu se dérouler peut aussi être dangereux, car les effets collatéraux existent. Puissent les Corses, dans leur ensemble et quels que soient leurs choix politiques, indiquer avec suffisamment de puissance à Emmanuel Macron qu’il est plus que temps de stopper ce jeu, et de passer à une autre phase, plus constructive. Et puissent nos lecteurs attentifs trouve ici quelques ressources pour déjouer les provocations qu’ils rencontrent dans d’autres contextes.
=====================
↑1 Le zugswang désigne aux échecs l’obligation de jouer, quel que soit le coup possible. Ce n’est pas en soi une provocation, puisque la règle du jeu interdit simplement de passer son tour, contrairement au jeu de Go. Mais, bien utilisé, le zugswang permet d’enfermer son adversaire dans une situation où il n’a que de mauvais déplacements possibles.
↑2 Les prémisses de la Seconde Guerre mondiale en Europe sont une série de provocation de la part de Hitler — réoccupation de la Rhénanie, annexion des Sudètes — auxquelles les puissances alliées n’ont su répondre que bien trop tard, et à quel coût ! En Asie, la guerre sino-japonaise, prélude de la Seconde guerre mondiale a démarré sur une provocation japonaise, lors de l’incident dit du pont Marco-Polo.
↑3 Il est de coutume de faire débuter la guerre américaine du Vietnam par l’attaque du destroyer USS Maddox dans le Golfe du Tonkin. Mais l’existence même de cet affrontement est controversé. En revanche, son utilisation par le Président des Etats-Unis pour accélérer l’intervention américaine au Vietnam est indiscutée. Encore une provocation qui devait coûter très cher au final.
↑4 Le triptyque “Provocation, Répression, Révolution” fut le leit-motiv des activistes les plus résolus en mai 68. Il est toujours au cœur des Black blocks. Pour d’autres provocateurs professionnels, il se transforme en diptyque, la provocation n’ayant d’autre objet que de justifier la répression. Mais dans tous les cas, un retour de flamme est très possible !