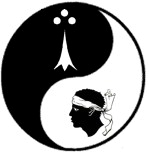La démocratie n’est pas simplement la loi de la majorité, c’est la loi de la majorité respectant comme il convient le droit des minorités.
Clement Attlee, discours, sept. 45
Deux débats — ou plutôt, malheureusement, deux “non-débats” — font aujourd’hui l’actualité institutionnelle de l’Union Européenne : le Brexit et le référendum d’indépendance de la Catalogne. Portons un regard attentif sur la façon dont l’Union Européenne traite ces deux sujets, car ils révèlent les valeurs et croyances — donc, l’idéologie — qui animent les hauts responsables de cette Union. Et partant, ils dévoilent le futur que ces hauts responsables souhaitent bâtir…
Le Brexit ou “la vengeance est un plat qui se mange froid”
24 juin 2016. L’establishment britannique et la quasi totalité de la classe politique européenne se réveillent avec une lancinante douleur au crâne : le peuple britannique n’a pas voté comme cela était prévu. Jusque tard dans la nuit pourtant, ils y avaient cru, au point que la livre sterling avait bondi face à la quasi-certitude de la victoire du “Remain”. Mais en finale, c’est le “Leave” qui l’emporte. Depuis lors, de l’eau a coulé sous les ponts de Londres, et il semble que l’establishment britannique, à l’exception de quelques irréductibles, s’en remette peu à peu. Les prévisions apocalyptiques se sont révélées pour le moins prématurées, et le sens de la Démocratie qui prévaut en Grande-Bretagne a conduit un parlement très majoritairement “pro-Remain” a finalement ratifier, pour se conformer au vote du peuple britannique, le déclenchement de l’Article 50 qui régit le départ d’un membre de l’Union.
Mais manifestement, les caciques de l’Union ne l’entendent pas de cette oreille. De Michel Barnier à Donald Tusk en passant par l’inénarrable Jean-Claude Juncker, une seule voix domine : les Anglais vont payer cet affront ! Ainsi, au lieu d’ouvrir des discussions loyales sur le type d’accord possible entre la Grande-Bretagne et l’Union Européenne, c’est une série d’ultimatums — sur la ”facture à payer”, sur les droits des citoyens européens, sur le rôle de la Cour de Justice Européenne, sur la frontière irlandaise — qui a occupé le devant de la scène. Dont acte : les négociateurs européens veulent faire mordre la poussière à la fière Albion pour préserver “nos” intérêts.
Mais au fait, quand avons-nous, nous, citoyens de l’Union Européenne, été appelés à exprimer comment nous voyons nos intérêts ? Pas dans les référendums où nous avons refusé la constitution européenne, puisque celle-ci a finalement été adoptée, camouflée en traité de Lisbonne. Pas non plus quand les Danois ont eu l’outrecuidance de refuser le traité de Maastricht, puisque l’on a vite annulé leur référendum pour en faire un second, avec une bonne réponse cette fois-ci, moins d’un an après le premier.
Car, au-delà d’un spectacle médiatique de négociations qui n’en méritent pas le nom, ce qui me frappe aujourd’hui concernant le Brexit, c’est le mépris avec lequel est traité le vote britannique de ce côté-ci de la Manche. Une seule explication est avancée : les Anglais ont succombé aux sirènes du populisme, et de toutes façons, ils n’ont jamais aimé l’Europe. Quand on regarde comment le UKIP a été laminé aux dernières élections, on devrait pourtant se rendre compte que le pays d’Europe où le populisme a le moins de prise, c’est… la Grande-Bretagne post-référendum. Quant au fait que les Anglais aiment ou n’aiment pas l’Europe, leur sang versé pour la sauver du nazisme devrait au moins conduire à un peu de retenue.
En réalité, la question du Brexit aurait mérité un débat bien plus approfondi : qu’est-ce qui fait qu’un pays membre, malgré les avantages économiques qu’il en tire, prend le risque de quitter cette Union ? Par quel raisonnement mystérieux les dirigeants de l’Union, au lendemain d’un vote où l’un des membres — et non le moindre, tant par la taille et le poids économique que par la tradition démocratique — vient de choisir “moins d’Europe”, arrivent-ils à la conclusion que ce qui est bon pour les peuples européens, c’est “plus d’union et plus d’intégration” ? Y a-t-il d’autre motivation que de faire payer aux Britanniques leur respect de la Démocratie, tout en rappelant aux autres qu’il y a des sujets interdits ? Rappelons-nous comment les mêmes dirigeants européens avaient déjà fustigé, en novembre 2011, l’idée émise par le Premier Ministre grec de l’époque de soumettre à référendum le “plan de sauvetage” qu’ils entendaient administrer à l’économie de ce pays. Avons-nous à ce point renoncé à la démocratie que nous acceptons sans broncher que ces dirigeants non élus sachent mieux que nous ce qui est bon pour nous ?
La Catalogne, ou “bas les masques”
Un an et demi après le catastrophique référendum britannique, rebelote, au sud des Pyrénées cette fois-ci. Les Catalans sont appelés à voter pour ou contre l’indépendance de leur nation. Mais là, le référendum est interdit par le gouvernement de Madrid. Il a quand même lieu, dans des conditions difficiles, et donne une majorité sans appel au “Oui à l’indépendance”. Les dirigeants catalans se tournent alors vers l’Union Européenne pour lui demander de faciliter les discussions entre Barcelone et Madrid. Après tout, les Catalans veulent leur indépendance par rapport à Madrid, mais veulent rester membres de l’Union Européenne. A l’instar d’autres nations non indépendantes, ils sont mêmes très pro-européens. Et l’Union n’a-t-elle pas fait clairement savoir aux Britanniques qu’ils devaient absolument s’arranger avec les Ecossais et avec les Irlandais s’ils voulaient avoir une chance d’avoir un bon deal ?
Mais la situation est bien différente ! Madrid n’a jamais questionné sa qualité de membre de l’Union, bien au contraire. Les Espagnols avaient même ratifié la Constitution européenne par plus de 75% de oui. Certes, la tradition démocratique n’y est pas la même qu’en Grande-Bretagne — où le gouvernement de David Cameron avait accepté et organisé un référendum des Ecossais sur leur indépendance, rappelons-le —, certes, la police tapant sur des gens qui ne veulent qu’exercer librement leur droit de vote, ça fait un peu désordre dans l’image idyllique que voudrait donner d’elle-même l’Europe, mais de deux maux, il faut choisir le moindre. Et pour nos dirigeants européens, les mêmes que ceux déjà cités, auxquels on peut ajouter Guy Verhofstadt, le patron du groupe parlementaire Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l’Europe (sic!), le plus grand danger, c’est de voir se défaire un état membre. Tout doit être mis en œuvre pour maintenir le statu-quo. Nos leaders européens, soutenus largement par Emmanuel Macron et Manuel Valls, iront jusqu’à dire que 27, on peut, mais que plus de 50 états ça serait impossible ! Alors, hors de question d’ouvrir la porte au séparatisme. Si les Catalans veulent être indépendants, ce sera clairement contre l’Union Européenne, et pas seulement contre Madrid. Et si Madrid veut mettre en prison leurs représentants élus, une atteinte intolérable à la démocratie si elle a lieu en Turquie ou ailleurs, c’est tout-à-fait acceptable et compréhensible vu les circonstances ! Pas un mot officiel d’une quelconque instance européenne, la Cour Européenne des Droits de l’Homme ayant semble-il perdu la parole en cette occasion.
La différence de traitement par l’Union Européenne entre Madrid et Londres ne peut pas ne pas interpeler tout observateur honnête. Mais surtout, ce deuxième référendum en quelques mois dans lequel des peuples européens expriment clairement leur volonté de ramener le pouvoir plus près d’eux devrait donner lieu à débat. Quelle Europe voulons-nous ? Comment voulons-nous exercer la démocratie en ce siècle à la fois d’ouverture au monde et de réseaux, de technologies de communication faisant de la planète un village et faisant du village un acteur possible de la démocratie planétaire. Nos dirigeants européens ne veulent pas de ce débat. Eux, ils savent. Laissons les faire, et silence dans les rangs.
Des recalés de la Démocratie
Certes, un tel débat serait complexe et long. Nous publierons prochainement quelques réflexions sur des principes qui pourraient fonder une démocratie du XXIe siècle. Il n’y a pas de recettes miracles, de réponses absolues. Mais, ce qui est sûr, c’est que le plus sûr moyen de ne pas avoir de réponse, c’est encore de ne pas se poser de question. C’est le choix que font les dirigeants européens. Y a-t-il de quoi s’en étonner ?
Peut-être pas si on prend la peine de s’attarder un peu sur le CV des trois figures principales de ce “non-débat”. Michel Barnier, le “Monsieur Brexit” de l’Union Européenne, s’est certes frotté au suffrage universel en son temps de Président de la Région Savoie. Mais sa carrière a bien plus été celle d’un homme d’appareils, de cabinets et de ministère que celle d’un leader politique. Jean-Claude Juncker a pour marque de noblesse d’avoir été le Premier Ministre d’un paradis fiscal (à l’époque) : le Grand-Duché du Luxembourg. Est-ce la meilleure école pour présider démocratiquement aux destinées de plus de 510 millions d’habitants ? Quant à Donald Tusk, son combat pour la démocratie en Pologne mérite tout notre respect. Mais est-ce suffisant pour apprendre à diriger le grand ensemble qu’est l’Union ? Un de mes amis, qui a vécu trente ans dans ce pays, me disait récemment : « En Pologne, il n’y a pas d’espace public. Le pays a été envahi tellement souvent que 90% des gens considèrent que leur responsabilité s’arrête à la porte de leur maison, et que le reste ne les regarde pas. » Est-ce dans ce type de contexte que l’on peut vraiment faire l’apprentissage de la démocratie ? En France, en Grande-Bretagne ou ailleurs, cela a pris plusieurs siècles, et il reste encore beaucoup à faire…
Comment se fait-il que l’Union aille chercher ses dirigeants dans les pays-membres qui ont le moins de tradition démocratique ? Ne peut-on y voir le signe indéniable d’une idéologie sous-jacente selon laquelle une bonne technocratie vaut mieux qu’une démocratie forcément imparfaite ? Ce point de vue pourrait d’ailleurs se défendre. Encore faudrait-il qu’il soit débattu démocratiquement avant d’être mis en effet. Faute de quoi, on pourrait se réveiller un jour prochain en réalisant combien Bukowski avait raison en écrivant : « La différence entre une démocratie et une dictature, c’est qu’en démocratie tu votes avant d’obéir aux ordres, dans une dictature, tu perds pas ton temps à voter. »
Si nous voulons plutôt incarner la vision de Clement Attlee qui ouvre cet article, alors il nous faut vite prendre conscience que ce n’est pas en confiant nos destinées européennes à des recalés de la Démocratie que nous construirons une Europe des peuples, solide, durable et libre.