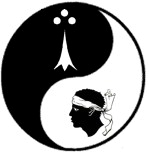Ce titre ressemble à un oxymore. Comment trouver en effet de la logique à une des activités les plus absurdes qu’ait inventée l’humanité ? Même le vainqueur d’une guerre endure des souffrances et souvent une régression que peu d’autres activités impliquent. Et pourtant…
Pourtant, la guerre répond bien à une (ou des) logique(s), au sens de manière selon laquelle s’enchaînent les événements (CNRTL-TLFi Logique C2), voire d’enchaînement cohérent obéissant à certaines conventions ou règles (ibid. C3). A l’heure où les bruits de bottes se font entendre de plus en plus fort à l’est de l’Europe, au Moyen-Orient ou du côté de Taïwan, il peut être utile de tenter de mettre en évidence ces mécanismes et de réfléchir à comment les gripper.
Causes et circonstances
La guerre étant une des activités les plus anciennes et récurrentes de l’histoire humaine, elle offre des sources innombrables d’analyse. Et ces analyses montrent que trois classes de causes, et trois seulement, provoquent des guerres.
La première cause de conflits est l’accès à des ressources réputées rares. Qu’il s’agisse des terres arables jadis, du pétrole récemment, de l’eau demain, certaines ressources sur terre sont mal réparties, et les groupes humains concurrents se déchirent régulièrement pour s’en approprier la part du lion. Ces ressources d’ailleurs peuvent ne pas être réellement rares ! Il suffit qu’une des parties prenantes le croit pour déclencher un conflit.
La deuxième cause est elle aussi bien ancrée dans l’histoire. Il s’agit des guerres de religion. Encore faut-il prendre cette expression dans un sens suffisamment large pour rendre compte des phénomènes psychologiques en jeu. Une religion n’a pas forcément à voir avec l’immanence. La Guerre froide entre le régime communiste et le libéralisme économique était clairement une guerre de religion, où s’affrontaient deux systèmes de croyances participant de l’identité même des groupes humains qui y adhéraient. Il est clair qu’aujourd’hui, les guerres de religion sont une composante forte des conflits au Moyen-Orient ou du terrorisme en Europe, mais n’y a-t-il pas aussi une telle dimension dans le conflit entre la Chine continentale et Taïwan ?
La troisième et dernière cause de conflits est peut-être la plus difficile à maîtriser puisqu’elle s’étend par nature dans le temps. Il s’agit des vengeances. Le conflit entre Palestiniens et Israéliens en fait un élément central du côté palestinien. La seconde Guerre Mondiale elle-même comportait une dimension forte de cet ordre dans la volonté allemande d’effacer l’humiliation de Rethondes et de Versailles.
Bien souvent, ces causes s’ajoutent et se combinent, pour donner naissance à des conflits plus inextricables les uns que les autres. La seconde Guerre Mondiale combinait les trois causes. Le conflit irlandais aussi. On peut en dire autant, sous certains aspects, du conflit israélo-arabe. Et alors, la tentation de trancher le nœud gordien par la guerre devient de plus en plus forte, au moins pour une des parties prenantes.

Car un conflit, même non résolu, n’est pas synonyme de guerre. Il peut y avoir démonstration de force, voire usage limité et ciblé de violence, sans y avoir à proprement parler une guerre. Ce peut être un préalable à une négociation qui, par une meilleure prise en compte des intérêts mutuels, permettra de le dépasser. Il est un exemple récent qui illustre cette possibilité de sortir d’un conflit par le haut : le traité de paix entre Israël et l’Egypte, qui a tenu et qui tient encore, malgré les printemps arabes et l’épisode des Frères musulmans, malgré la guerre en cours à Gaza.
La guerre, elle, est une lutte armée violente entre groupes humains, qui finit toujours, comme le rappelle Clausewitz, par “monter aux extrêmes” pour détruire l’adversaire. Ce qui aujourd’hui, avec les armements modernes, est (serait ?) une catastrophe absolue. Pour qu’un conflit devienne une guerre, il faut des circonstances particulières. Et c’est bien là que le bât blesse, parce que nombre de ces circonstances sont présentes dans l’Europe d’aujourd’hui.
Hubris et malentendus
Ce ne sont pas les peuples qui déclenchent les guerres, ils sont bien trop conscients qu’ils en sont les premières victimes. Ce sont leurs dirigeants qui les déclenchent, et l’hubris, là encore, joue un rôle premier. Car on ne déclenche pas une guerre si on n’est pas convaincu d’en être le vainqueur. Or, cette conviction n’est souvent qu’illusion et surestimation de soi. Les deux Guerres Mondiales, la guerre de Corée, la guerre du Vietnam américaine, les multiples guerres d’Afghanistan rappellent à qui veut bien s’en souvenir qu’il y a loin de la coupe aux lèvres, et que le champagne de la victoire se transforme facilement en amère potion de la défaite. Pourquoi alors y a-t-il encore des guerres, déclenchées souvent par leurs futurs vaincus ?

La guerre est avant tout une histoire de malentendus. L’hubris de quelques dirigeants à l’ego malade les empêche de raisonner sainement et de voir les faits. Napoléon n’a jamais compris la détermination des Anglais à l’empêcher de dominer l’Europe. Hitler, comme Napoleon, n’a pas vu l’immensité toujours invaincue de la Russie. Bush n’a pas perçu la résolution inébranlable des Afghans à rester insoumis, et l’atout que constitue leur géographie. Sadam Hussein avant lui n’avait pas perçu qu’envahir le Koweït le mettrait face à une coalition internationale invincible. Là encore, on pourrait multiplier les exemples. Clausewitz appelait cela le brouillard de la guerre, mais il s’agit bien plus du brouillard qui envahit l’esprit de dirigeants à l’ego surdimensionné.
Pour qu’un conflit devienne une guerre, il faut qu’au moins une des parties se trompe, en surestimant sa force ou en sous-estimant celle de son adversaire. Rappelons-le, on ne fait pas la guerre si on est sûr de perdre. Et pour qu’une “petite” guerre devienne une “grande” guerre, il faut en plus que d’autres en rajoutent. Les récents développements au Moyen-Orient avec l’Iran et ses proxies montrent les engrenages en marche. On a tout écrit sur les logiques d’alliances qui ont conduit à la boucherie de 14-18. La même logique a pourtant conduit, vingt ans après, à la deuxième Guerre Mondiale.
En citant cette dernière, je suis conscient de la difficulté. Qui en effet peut contester le fait que la Pologne était l’agressée, et que stopper l’agresseur revêtait une dimension morale forte ? Mais ne nous y trompons pas. Même si une guerre semble “juste”, elle n’en demeure pas moins la pire façon de résoudre un conflit. Et qu’est-ce qu’une guerre juste ? Le camp du Bien serait-il fixé une fois pour toute ? En 1939, la Pologne a été agressée à la fois par l’Allemagne hitlerienne et par la Russie soviétique, celle-là même qui, devenue l’alliée des “démocraties”, brisera quatre ans plus tard le rêve du Reich de mille ans. Pas plus que de guerre propre, il n’y a de guerre juste. Aujourd’hui, par exemple, le droit de la Russie sur la Crimée ou le Donbas est aussi juste, vu de Moscou, que l’exigence d’intégrité territoriale de l’Ukraine vue de Kiev, Washington ou Paris/Londres. Le droit des Israéliens à vivre en paix sans menace terroriste est aussi fort que celui des Palestiniens à avoir un État.
On comprend que pour les parties prenantes directes au conflit, il y ait des exigences morales incontournables, et que chercher à mobiliser des alliés est alors naturel. Ces alliés peuvent d’ailleurs contribuer à dissuader un agresseur. Mais il y a une question de temporalité. Pour véritablement dissuader, il faut agir avec fermeté avant la guerre. Quand le conflit s’envenime, c’est que la dissuasion a échoué, et l’heure doit alors être à une extrême prudence pour empêcher un embrasement généralisé. Ceci devrait être la règle pour ceux qui gardent la tête froide. Or, c’est souvent l’inverse que l’on constate. Car, là encore, l’hubris des dirigeants obscurcit leur jugement. Ils se croient suffisamment forts avant pour peser par leur seule présence, suffisamment intelligents après pour maîtriser l’engrenage. Il n’en est rien. Kennedy s’est fait piéger au Vietnam, alors que son prédécesseur, Eisenhower, s’était soigneusement abstenu d’y mettre le premier soldat. Peut-on croire que le Républicain Eisenhower était moins anticommuniste que le Démocrate Kennedy ? Il était simplement, par son métier et son histoire, plus au fait de la force irrésistible de certains engrenages. Parce qu’une fois enclenchée, la logique de la guerre emporte tout.
Ce sont bien ces malentendus et ces hubris incontrôlés qui rendent la période que nous vivons depuis quelques années si dangereuse. Qu’un Macron joue les va-t-en-guerre un coup de trop, et celle-ci pourrait bien arriver.